Histoire non compressée du MP3
Il a bouleversé notre façon de consommer la musique, tué l’industrie du disque, aidé Apple à devenir gras comme un cochon, s’est mis à dos des stars comme Metallica et fête aujourd’hui ses 20 ans. Le nom de cet ado qui vit ses dernières heures : le MP3. Histoire d’un rêve devenu cauchemar.
« Dans les années 2000, la demande sera telle qu’il n’y aura plus que des réponses. Tous les textes seront des réponses, en somme. Je crois que l’homme sera littéralement noyé sous l’information, dans une information constante. (…) On repassera par la gratuité. C’est à dire que les réponses, à ce moment là, seront moins écoutées » (Marguerite Duras, interview septembre 1985)
En reprenant l’histoire à l’envers, Marguerite avait raison. Sans le savoir. Avec 30 ans d’avance. Sur ce qu’est en train de devenir la fameuse société du spectacle de Debord. Sur l’essor de l’abreuvoir à images MTV. Sur la fabuleuse arnaque marketing qu’est le Compact Disc alors à son zénith. Sur le besoin intarissable de l’homme moderne d’en (s)avoir toujours plus en deux fois moins de temps. Et enfin sur l’évolution de l’œuvre d’art qui, pour citer André Breton, « n’a de valeur que dans la mesure où elle frémit des réflexes de l’avenir ». Si à la mi-temps des années 80 ce picotement qui s’apprête à radicalement et durablement changé notre manière de consommer la culture n’a pas encore de nom, quelque chose est en train de changer. Personne ne le sait, mais tout le monde le sent. La grande révolution dont il est ici question, et qui rythme encore nos quotidiens digitaux, c’est celle du MP3. Pour MPEG Audio Layer 3. Un terme un peu barbare cachant une réalité beaucoup plus concrète à base de disques ne pesant pas plus lourd qu’une poignée de kilobits dans un monde où tout est désormais accessible partout, disponible nulle part. Et dans lequel nous ne cessons de baigner encore aujourd’hui, plus de 20 ans après la création du célèbre rouleau compresseur. MP3. Au départ, rien de plus de que deux petites lettres un chiffre. A la fin, un siphon technologique autant capable d’apporter la pop culture sur un plateau d’argent au premier gamin venu que d’emporter tout ce que l’industrie du divertissement a mis près d’un demi-siècle à construire.
Dans cette histoire, il y aura du bon et du mauvais, des pertes et des blessés. Mais si Maggie a su prophétiser avant tout le monde l’invention de Youtube, Spotify, Netflix et consort, il y a une chose que l’écrivaine n’avait pas prévu : comment tout cela avait commencé. Et pourquoi, en même pas deux décennies, on était passé de la beauté du disque d’or à la grisaille des disques durs. Générique d’un film dont personne ne sortira gagnant.
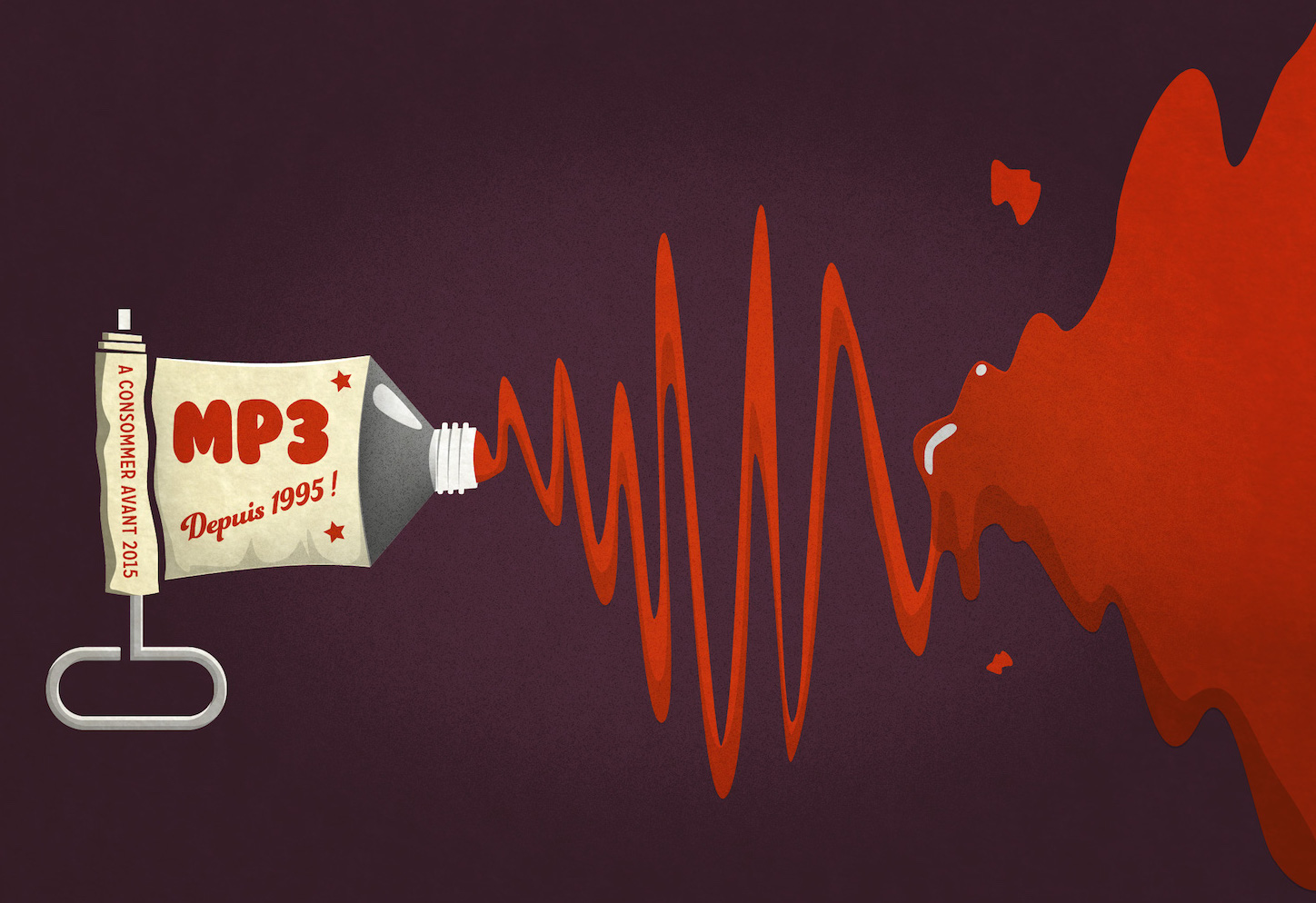
Ruée vers l’or(dinateur)
Comme dans toute conquête, il y a des pionniers. Ceux qui vont contribuer à enterrer le support le plus populaire de l’époque – le CD – donnent le premier coup de pioche en 1988. Et contre toute attente, ils ne portent ni casquette à l’envers, ni T-Shirt antisystème. Parce qu’au départ, derrière ce qui nous permettra bientôt de nous gaver de téraoctets de musique pour le prix d’une connexion internet, il y a la main de Dieu. Enfin, celle de François Mitterrand. Et d’Helmut Kohl. C’est un fait méconnu, mais le MP3 doit son existence au projet EUREKA, un programme soutenu par les deux chefs d’état et financé par l’Union Européenne dans le cadre d’un renforcement de l’industrie du vieux continent. Parmi les projets défendus, il y a celui disposant d’un nom de code pour une bombe atomique : EU-147. Ce n’est certes pas encore le MP3, mais ça y ressemble. Au cœur de cette bataille de brevets qui opposera dès 1991 deux formats audio concurrents (l’ASPEC soutenu par AT&T et Thomson contre le MUSICAM d’Apple et Philips, qui gagnera finalement la partie), une question simple. Et pire que ça même : une question connement technique. Comment compresser sur les disques durs minuscules de l’époque – environ 500 mégas – toutes les informations contenues sur un CD ? Dans le monde du cirque, on parlerait de faire rentrer un éléphant dans une boite à chaussures. Sans jeu de mots, l’enjeu est de taille ; c’est l’équivalent du limbo appliqué au monde des cartes mère. Réduire sans détruire, le principe même de toute avancée technologique.
Afin de mener à bien ce pari titanesque pour l’époque, une poignée de chercheurs en blouse et colliers de barbe est convoquée par l’organisation internationale de normalisation – les fameuses normes ISO – et réunie au sein d’un pool qui plus tard donnera son nom au format numérique : le Motion Picture Expert Group (MPEG). Dans le bunker à chambre d’échos, un homme va avoir la lourde tâche d’harmoniser les violons pour arbitrer les débats qui animent l’ensemble des chercheurs du projet, mais aussi les entreprises attirées par l’odeur du pognon. Son nom : Hans Georg Musmann. C’est un professeur de l’université d’Hanovre qui jusque là s’est fait reconnaître pour ses travaux sur l’encodage des systèmes d’informations. A première vue, Hans, 55 ans à l’époque, n’a pas le profil type d’un Oppenheimer des caissons de basse. Sauf qu’après plus de 6 ans de recherches, entre 1988 et 1994, et de bras de fer avec les industriels pour imposer un format standard, le divin enfant est né. Grâce à la magie successive des codecs MPEG 1, puis 2, et finalement 3 (ce dernier étant alors considéré comme le plus robuste) il pèse dix fois moins lourd qu’un morceau de compact disc. En mars 1994, le MP3 sort donc officieusement du laboratoire. Et s’il n’est pas encore connu du grand public, son nom ne va pas tarder à faire trembler la planète fun.
« Thank you Fraunhofer »
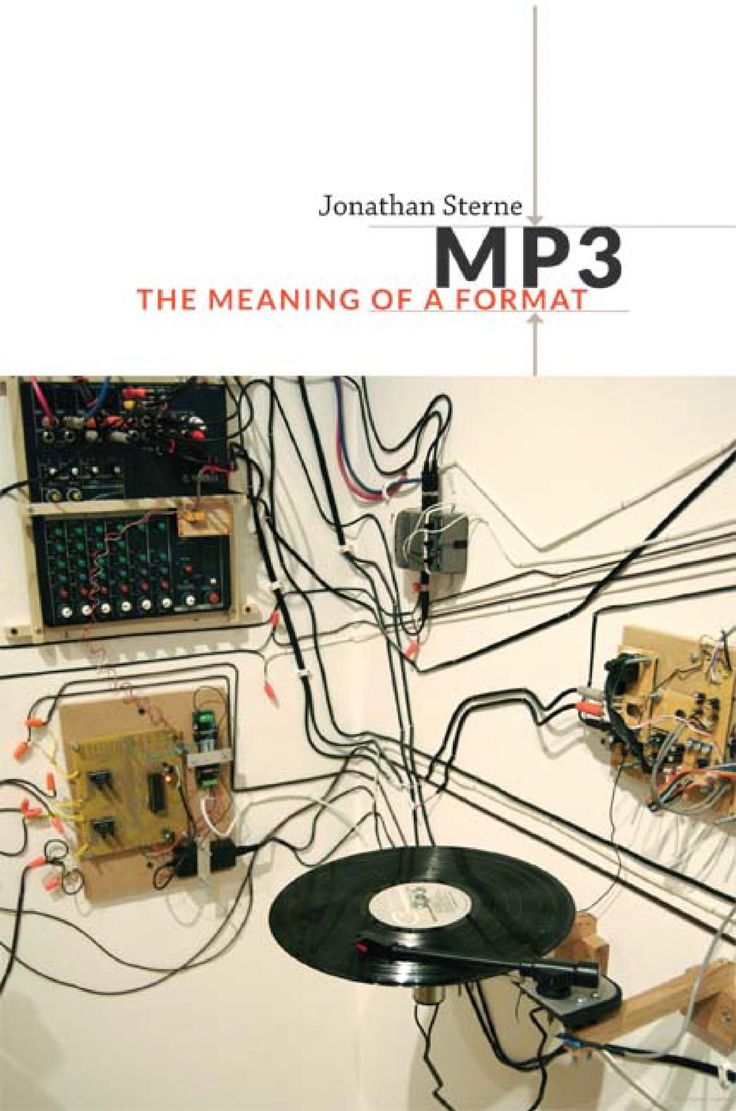
En juillet de la même année, la société Fraunhofer – déjà partie prenante dans la genèse du format compressé – développe le premier logiciel capable d’encoder en MP3 des pistes audios. L3enc, tel est son nom, est une première pierre posée sur les fondations de la musique numérique. Et comme le précisera en 2012 l’auteur Jonathan Sterne dans son livre MP3 : The Meaning of a Format, c’est le genre de pierre qui se transforme en gros caillou dans la chaussure. Récupéré par un étudiant australien grâce à une carte bleue volée, le logiciel L3enc est immédiatement customisé par le jeune hacker qui, fier de la nouvelle interface (rendue plus accessible et plus simple) balance sa nouvelle version sur les réseaux. Il faut dire que le pirate ne manque pas d’humour ; L3enc est redistribué gratos aux internautes sous le nom « Thank you Fraunhofer »… Et c’est vrai qu’il y a de quoi les remercier. Partagé par des millions d’étudiants jusqu’en 1998, le cadeau contribuera pour beaucoup, non seulement à la popularisation du MP3 auprès des jeunes générations, mais aussi à la constitution d’une première base de données de chansons numérisées à une époque où seule une poignée de particuliers disposent d’ordinateurs assez puissants pour faire tourner l’encodeur. En quelques mois, la propagation du L3enc est gigantesque ; un nouveau paradigme est en marche, rythmé par le bruit des modems 56K qui permettent d’envoyer et recevoir un morceau à l’autre bout de la planète. Et si L3enc a sans le vouloir contribuer à l’émergence d’un nouveau modèle de distribution de la musique, il a accessoirement permis à Fraunhofer de s’en mettre plein les poches. Pas rancunière, la firme commercialise en septembre 1995 une nouvelle version de son logiciel nommée WinPlay3, qui restera dans l’histoire comme le premier player familial. Dix ans plus tard, la calculette de Fraunhofer fait péter les scores : la licence MP3 lui a déjà rapporté plus de 100 millions d’euros de bénéfices.
Etonnamment, l’industrie du disque peine à réagir quand survient l’un des premiers leak de l’histoire. Nous sommes en novembre 1997. Un fan hongrois de U2 vient de charger illégalement l’intégralité d’une copie promo du disque « Pop » des Irlandais sur Internet. C’est le début de la grande saignée. Après la distribution gratuite – et férocement illégale – de la musique de U2, c’est quelques semaines plus tard au tour de Clapton, Van Halen ou Metallica de voir leurs nouvelles chansons sacrifiées publiquement sur un site disposant d’un seul mois d’existence : MP3.com. Financé par les bannières de publicitaires attirés par l’énorme trafic, le site devient dès janvier 1998 le deuxième mot clef le plus populaire sur internet après l’indémodable « pornography ». Peu importe que le téléchargement d’une seule chanson prenne parfois des plombes, et tant pis si la qualité d’encodage (128 kilobits) laisse parfois à désirer, le mal (ou le bien, c’est selon) est fait. Avec le lancement du player Winamp en 1997, puis du premier baladeur MP3, commercialisé par Rio en dépit de la RIAA (l’association de défense de l’industrie du disque américaine) pour l’en empêcher, c’est le basculement dans un nouveau monde où les pirates d’hier vont durablement devenir des héros. Et quelque part, c’est un peu notre histoire à tous.

Préférer la copie à l’original
« L’une des tâches primordiales de l’art a été de tout temps de susciter une demande, en un temps qui n’était pas mûr pour qu’elle pût recevoir pleine satisfaction ». Cette vérité industrielle est énoncée dès 1935 par Walter Benjamin dans ce qui reste certainement l’ouvrage le plus pertinent sur le sujet : L’œuvre d’art à l’heure de la reproductibilité technique. Soixante ans avant l’invention du MP3, on y trouve notamment la clef d’une énigme : pourquoi l’industrie du disque, pourtant grasse et opulente comme jamais au milieu des années 90, n’a pas su contrer la révolution gris métal couleur disque dur. La réponse est pourtant simple : la position dominante empêche l’anticipation. Et alors que les 5 majors les plus puissantes en sont encore à écouler par camions entiers un Compact Disc à 17 dollars pièce à des kids empapaoutés qui ignorent son prix de production diablement bas, elles n’ont simplement pas le temps nécessaire pour comprendre que ces mêmes gamins vont désormais vouloir piocher directement dans l’usine à bonbons. « Il est du principe de l’œuvre d’avoir toujours été reproductible » rajoute Benjamin, ce que des hommes avaient fait, d’autres pouvaient toujours le refaire ». Nous en sommes précisément là à la fin des années 90. Gouvernées par des pontes ventripotents n’ayant certainement jamais touché une souris de leur vie, et faute de comprendre ce qui leur arrive, les majors baissent non seulement la culotte face au piratage, mais invitent également les internautes à s’y engouffrer par millions.
Dans un magazine Wired daté de 1999 avec une couverture équivoque (« I WANT MY MP3 »), le journaliste Vito Peraino résume bien la position d’une industrie qui refuse de voir l’hémorragie sur sa jambe gauche : « A l’image d’un million de photocopieuses Xerox sous stéroïdes, la copie et la distribution désormais offerte par Internet viennent de donner un sérieux coup sur l’oreille du droit d’auteur. L’année dernière (1998, NDR), ce sont près de 846 millions de CD’s qui ont été vendus à travers le monde. Mais chaque jour, ce sont au moins 17 millions de fichiers MP3 qui circulent sur Internet ». Comme dit le proverbe : il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Le grand bug de l’an 2000, ce sera donc la surdité continue de l’industrie du divertissement.
Un bug qui, pour revenir aux visions de Walter Benjamin, n’a pourtant rien de surprenant. Après l’imprimerie et la photographie, la musique sera donc le dernier des mediums à devenir reproductibles. Un travail de sape débuté dès le début du 20ième siècle qui fait perdre à l’œuvre son caractère unique, et donc sa fonction d’icône religieuse. « Dès lors que le critère d’authenticité n’est plus applicable à la production artistique » rajoute Benjamin à une époque où l’on n’a pas encore découvert l’enfer de Kayne West en streaming, toute la fonction de l’art se trouve bouleversée ». Fin des années 90, le rituel, s’il n’est plus devant l’œuvre, s’est donc déplacé devant un écran. Et dès lors le culte ne se vouera plus jamais à l’objet, mais au support. C’est là qu’entre en scène Shawn Fanning.
L’heure de Napster…

Ce n’est peut-être pas pour rien si Napster rime avec gangster. Pourtant quand l’ado américain Shawn Fanning écrit à l’âge de 18 ans le code informatique à l’origine du premier logiciel peer to peer, il est loin de se douter que sa bête monstrueuse va bientôt donner des sueurs froides à toute une industrie. Mais pour comprendre Napster, il faut d’abord revenir à l’année 1999. L’idée d’un réseau de partage 100% numérique 100% illégale ? Elle lui est venue sur un campus universitaire de Boston en écoutant son voisin de chambrée râler sur les liens de téléchargement MP3 rendus inactifs par des ayants droits aux abois. Du genre autodidacte et obsessionnel, Fanning a ceci de commun avec Mark Zuckerberg qu’il s’est rodé aux langages de programmation dès son plus jeune âge sans savoir encore comment mettre ce savoir en pratique. C’est pourtant là, sous ses yeux : un paquets de chansons dorment sur des disques durs aux quatre coins du monde, suffit juste de les relier. Et puisque la constitution américaine permet – depuis le Audio Home Recording Act de 1992 – aux citoyens d’enregistrer puis partager de la musique dès lors qu’il n’y a pas d’exploitation commerciale, autant en profiter. Bah ouais mon con. C’est que Shawn s’apprête à réaliser. Avec en sourdine une obsession qui ne le quittera plus : et si quelqu’un, sur un autre campus, venait à avoir la même idée que lui ? Dans l’ombre de sa chambre étudiante, il concocte un sérum pour une maladie qui n’existe pas encore lors de séances de programmation qui peuvent aller jusqu’à 60 heures de travail non stop, avec pour seul répit un bol de céréales.
Et alors que ses parents croient que le gentil Shawn joue au solitaire sur son ordi, le voici donc qui lance finalement en juin 1999 l’ancêtre de Kazaa, Edonkey et bien plus tard de sites de piratage organisés comme Pirate Bay et autres dérivés BitTorrent. La réponse est massive. En l’espace de deux ans et jusqu’à sa fermeture forcée en juillet 2001, Napster fait perdre des millions de dollars à l’ensemble des majors encore sous le choc. A Esquire, le désormais trentenaire Fanning confiera plus tard que « l’effort collectif pour améliorer l’Internet battra toujours ceux qui tentent de l’exploiter ». Et c’est vrai que dans le contexte de l’époque, engoncée dans l’ennui bourgeois, l’ado vient simplement d’inventer un monde nouveau où les règles sont claires : il n’y en a plus.
« Je ne sais pas comment arrêter Napster. Si vous pouvez voler de la musique, alors vous pouvez prendre n’importe quoi » (Val Azzoli, co-Président d’Atlantic Records)
Placardé en couverture de titres aussi prestigieux que Fortune ou Forbes, le fondateur de Napster vit au détour de l’an 2000 son quart d’heure de gloire. Devenu porte parole d’une génération excitée par le vol à la sauvette, Shawn Fanning est ce bad boy aux yeux clairs que chacun de nous aurait rêvé d’être, au moins le temps d’un téléchargement. On le retrouve aux MTV Video Music Awards pour introduire Britney Spears, au volant d’une rutilante Mazda RX-7, et même dans le Time dont il fait également la Une, et où le jeune prodige explique comment Napster est une simple réponse à la demande croissante des utilisateurs en bonne marchandise, notamment pour les titres obscures jusque là introuvables sur le marché. Vu comme ça, Napster rime aussi avec dealer. Mais la fête ne pas durer longtemps. Rattrapé par la justice, Dr Dre et Metallica qui rien qu’à eux seuls exigent 10 millions de dollars de dommages et intérêts, celui qui se voyait déjà en icône de V pour Vendetta finit par déchanter. Il ne faudra rien de plus qu’un vice de forme dans la procédure qui oppose Fanning à, grosso modo, tout le monde, pour faire tomber le château de cartes. Quand le juge en charge de l’affaire révèle que l’un des dirigeants du groupe Bertelsmann – l’un des principal plaignants du procès – possède également un pied dans le camp de Napster, l’affaire est pliée. Et le site contraint de fermer après avoir réglé une ardoise de 26 millions de dollars aux ayant droit bafoués. Puis d’être racheté par… Bertelsmann… pour devenir un service légal et… payant. Napster, plus fort qu’un épisode de Plus belle la vie.
« Avec ou sans moi, tout cela serait arrivé tôt ou tard, confiait récemment le trentenaire millionnaire au San Francisco Gate, il fallait que les labels s’adaptent aux évolutions permises par la technologie ». Et le pire, c’est que c’est vrai. La morale de cette parenthèse libertaire, c’est qu’aussi sûr que les bons gangsters ne sont jamais coffrés, on ne mettra jamais un format dématérialisé derrière les barreaux.
… And nothing else matters
Paradoxalement, la fermeture définitive de l’usine à gaz Napster annonce le véritable début des emmerdes. Pour les musiciens notamment, qui ont beaucoup à perdre dans cette lutte contre un ennemi invisible : leur public. Fers de lance d’une guerre menée discrètement par peur de se mettre les consommateurs à dos – à cette époque il en reste encore – Metallica devient dès le début des années 2000 le porte étendard d’une cause perdue d’avance. Raillée par les médias pour leur résistance au changement, traitée de gros ringards par les gamin de la génération Y, la bande à Ullrich sera pourtant l’une des seules à monter au créneau. Revenant sur les faits dix ans plus tard alors qu’on lui demandait son avis sur la mort de Napster, le batteur du groupe ne concèdera aucun regret : « Etions-nous des gardes fous ? Oui. Les gens avaient-ils vulgairement sous-estimé l’importance de cette bataille ? Certainement. Je suis fier que le groupe soit resté debout pour défendre ses principes et ses convictions. En distribuant gratuitement l’intégralité de notre catalogue, Napster a kidnappé notre musique sans nous demander la permission ». Bien envoyé, Lars !
Mais le bombement de torse n’empêchera pourtant pas le groupe de voir ses ventes décliner dès le début des années 2000. Après l’exploit du « Black Album » écoulé à 16 millions d’exemplaires rien qu’aux Etats-Unis en 1991, ce sera comme pour tout le monde la longue descente douce dès le début du nouveau millénaire : 6 millions de copie pour « Saint Anger » en 2003, et trois fois moins pour « Death Magnetic » en 2008. Preuve que même le village des irréductibles semble, sous les coups de boutoir de la génération MP3, prendre l’eau.
« En moins d’une semaine nous sommes devenus le plus grand distributeur de musique au monde » (Steve Jobs)
Poussé par ses propres intérêts économiques, l’industrie du disque lance à son tour dès 2003 une vaste chasse aux sorcières. Le 8 septembre, plus de 260 utilisateurs de logiciels peer to peer sont poursuivis en justice. Véritable inquisition de ceux qui ne croient plus au système payant, c’est presque une première dans l’histoire du capitalisme : des entreprises se retournent contre des clients néo-marxistes détruisant le capital, non pas par haine de celui-ci, mais par simple plaisir. Si la carrière de milliers d’artistes n’étaient pas en jeu, et derrière elle l’idée même de la création musicale, l’affaire aurait presque de quoi faire rire. Mais là où la répression aurait du calmer les ardeurs au téléchargement illégal – et ce jusqu’à l’échec récent d’HADOPI, elle va en fait décupler l’appétit pour la destruction. De par son mode de fonctionnement et le discours écrit pour défendre son propos – désormais la culture appartient à tout le monde – il était écrit que le MP3 survivrait à ses détracteurs, comme à ceux qui se rassurent en prétextant qu’ils « achètent encore beaucoup de vinyles » (un format qui ne représente en 2014 pas plus de 5% des ventes globales, mollo les basses sur le retour miraculeux). De fait, et comme avec le Front National, les vrais fautifs ne sont pas ceux qui créent les solutions (finales ou pas), mais ceux qui les utilisent. Sans le savoir, au fil des ans nous sommes tous devenus les Dieudonné du peer to peer, apôtres antisystème sans motif politique autre que celui consistant à voler les godasses de ceux qui nous font danser. Et ne venez pas jouer pas les vierges effarouchées. Si vous êtes avant les années 90, il y a de forces chances pour que vous aussi, vous ayez du sang sur les mains.
Ou plutôt des fichiers illégaux stockés sur un disque dur. Braquée sur l’industrie occidentale, la tête nucléaire s’enclenche finalement en 2001 avec l’arrivée d’Apple sur le terrain miné qu’est devenu le secteur de la musique digitale. Avec iTunes, Steve Jobs vient d’imaginer la rampe de lancement idéale pour le MP3.
Le ver est dans la pomme

« Apple est heureux d’annoncer la naissance d’iTunes, le plus grand jukebox jamais conçu. J’espère que son interface "dramaticalement" simple
saura aider encore plus de monde à entrer dans la grande révolution de la musique digitale ». Les mots prononcés par Steve Jobs en ce début d’année 2001 sonnent, avec le recul, comme l’ouverture du bal des vampires. Sur le coup pourtant, le monde – et nous avec – est aux pieds du fondateur d’Apple. Si l’annonce est effectivement une révolution en soi et détrône rapidement Winamp et le Windows Media Player dans le cœur des pro-MP3, elle est aussi l’occasion d’une revanche pour celui qui s’est fait dégager de sa propre boite 15 ans plus tôt. Revenu aux manettes d’Apple, le voici qui annonce fièrement le lancement d’iTunes – avec une version évoluée du MP3, le format AAC – suivi 6 mois plus tard d’une autre invention pour compléter la panoplie du parfait pirate : l’iPod. Un petit objet en plastique capable de stocker 1000 chansons téléchargées illégalement. Au revoir veau, vache, walkman et CD. « Combien de fois vous êtes vous dit ‘’oh mince je voulais écouter cette chanson mais j’ai oublié le CD à la maison ? s’interroge Job,
Le génie de l’iPod, c’est d’avoir l’intégralité de votre discothèque sur vous 24/24, dans votre poche ». Pour Apple, ça le sera littéralement. En inventant la synchronisation des supports à une époque où aucune plateforme légale d’envergure n’a encore été crée, Steve vient surtout d’inventer la cartouche explosive qui manquait au MP3 pour tout flinguer : business model traditionnel des majors, rémunération des artistes, habitude de consommation du grand public, réseaux des disquaires indépendants. Ce que les médias ignorent de la conception de l’iPod, c’est que la petite révolution blanc nacré n’a pas été accouché sur un chemin pavé de roses.
L’iPod est en réalité né dix ans plus tôt sous les doigts d’un informaticien nommé Anthony Fadell. Né américain mais d’origine libanaise, il a cet inconvénient qu’ont souvent les inventeurs un peu trop perchés : à trop être en avance sur son temps, on arrive parfois en retard. Il faut dire qu’au début des années 90, l’idée de l’ex salarié d’Apple a tout d’une illumination. Son idée : vendre un petit baladeur fonctionnant avec un mini-disque dur. L’inventeur déposera ses brevets, fondera même une société (Fuse) pour porter le projet. En vain, le monde, pas plus que les ordinateurs – rappelez-vous le MP3 en est encore à ses balbutiements à Hanovre – n’est encore prêt. Pas mauvais perdant, l’inventeur part inventer ailleurs. Puis revient chez la marque à la pomme pour concevoir, je vous le donne en mille… l’iPod ! Un bon timing pour Jobs, et qui plus est à un moment charnière pour Apple : depuis le retour de l’enfant prodigue en 97, les dettes s’accumulent, l’entreprise est au bord du dépôt de bilan et peine à trouver le remède miracle. Il va finalement lui être servi sur un plateau, et avec des écouteurs. Pour cela il va falloir bosser, et pas qu’un peu. Invitées poliment par Jobs à se bouger le cul pour tenir les délais de conception, Fadell a un chronomètre greffé devant ses mirettes. Pour ne pas voir le projet iPod remisé au placard faute de liquidités, mais aussi pour éviter que la concurrence ne s’empare de l’idée de génie, les équipes et ne verront pas grand chose de l’année 2001. Entre 18 et 20 heures par jour, 7 jours sur 7 avec du team building à l’américaine. Boosté par le risque de voir le projet décalé d’une année (l’iPod doit être lancé avant Noel, chaude période commerciale par essence), Fadell plonge les équipes Apple dans un transfert freudien de première classe : s’ils échouent, c’est qu’ils n’aiment pas assez le produit dans lequel ils sont sensés croire, s’ils échouent, c’est qu’ils n’aiment pas assez l’enfant qu’ils sont en train d’accoucher Et s’ils perdent cette guerre, c’est finalement parce que ces fourmis ouvrières n’ont pas été assez patriotes pour dignement servir leur pays.
La méthode hésité d’Apocalypse Now finira par payer. Après 6 mois de travail intensif, l’iPod voit le jour en octobre 2001, suivi deux ans plus tard par l’iTunes Store, dernière pierre d’un édifice pharaonique. En assurant son autosuffisance sur un marché du MP3 encore balbutiant, et en rendant chacun des supports dépendants les uns des autres, Steve Jobs vient de réussir le hold-up du siècle. Quatorze ans après le début de cette success story comme seule l’Amérique sait en fabriquer, l’histoire qui unit le MP3 à Apple se lit comme un bon roman de mathématicien et la suite n’est qu’une série de chiffres qui donnent le vertige : 400 millions d’iPod vendus depuis 2001, 1 million de chansons vendues sur l’iTunes Store rien que pendant la première semaine d’exploitation, 700 milliards de capitalisation boursière pour Apple à la fin 2014 (loin devant l’ennemi juré d’hier, Microsoft). Tout cela, accessoirement, grâce à des morceaux vendus à l’unité 99 centimes d’euros dont seulement 30 % revient au final dans les poches de l’artiste. Nette et sans bavure, même pas le temps d’avoir mal. Un braquage à l’italienne.
« Je vais certainement passer pour un vieux has been mais je tiens Steve Jobs pour principal responsable de la mort de l’industrie du disque » (Bon Jovi)
Cupertino, on a un problème
Pour mieux comprendre comment Apple est parvenu à imposer des taux de rémunération pas vus depuis l’esclavage alors même que l’arrivée du format MP3 – combinée à l’émergence des home studios – a permis une réduction drastique des couts de production, il faut une nouvelle fois remonter au 23 octobre 2001, date d’annonce de l’iPod. Ce jour là Steve Jobs se lance dans ce l’une de ses célèbre « key notes », soit une adaptation des discours crypto-bibliqués hérités des sectes pour convertir les nouveaux fidèles à la religion du nouveau siècle : la technologie. Après 20 minutes de préliminaires, Steve commence par comparer le cout d’une chanson fonction des supports d’écoute : 5 dollars en moyenne pour une chanson sur un CD (qui peut en contenir une quinzaine au maximum), 0,30€ pour une chanson sur un iPod, qui peut en contenir 1000. Le calcul est implacable. En une séance, Jobs vient de faire chuter le cours de la musique de 80%. Et il le sait.

Le bémol de l’histoire, et c’est toute l’ironie de cette présentation rondement bien menée, c’est qu’on aperçoit derrière Big Steve une pochette d’un album des Beatles, « Hard’s day night ». Un groupe avec lequel il s’apprête à rentrer en procès pour de longues années. Fallait pas croquer dans la pomme, Steve… la raison du courroux ? L’utilisation supposément frauduleuse de la marque Apple (une marque déposée par les Beatles pour leur label en 68) alors même que Jobs s’était initialement engagé à ne pas engager son entreprise dans le secteur de la musique. Un serment d’hypocrite bafoué, et surtout le catalogue complet du groupe le plus influent du 20ième siècle absent de la plateforme iTunes. Avec, en trame de fond, une question centrale : le montant colossal des droits d’exploitation dudit catalogue.
Si le conflit finira par se régler en 2010 avec à la clef un prix de vente exceptionnellement fixé à 1,29 € la chanson des Fab Four, l’anecdote peine à cacher ce qu’Apple est devenu au cours de la dernière décennie : une solution aux antiPodes du problème initial. Et qui, combinée aux effets dévastateurs du MP3, va aboutir à l’appauvrissement de toute une profession, puis à l’apparition du streaming légal, autre pansement sur une jambe de bois qui réduira encore plus les maigres bénéfices dus aux musiciens ; sans qui pourtant aucun des rouages de cette nouvelle économie ne saurait tourner.
Aux conditions draconiennes imposées par Apple se rajoutent également des limitations, comme l’impossibilité pour label et artiste de fixer librement le prix de vente des morceaux distribués sur iTunes, ou encore l’interdiction de la vente des albums en pièces détachées, c’est à dire morceau par morceau. Face à tant de contraintes, un timide vent de contestation se lèvera au milieu des années 2000 sur Cupertino, siège d’Apple. Ce sont d’abord des artistes comme les Red Hot Chili Peppers ou Metallica qui, par le biais de leur manager Mark Reiter, sonneront la charge : « il est impensable de laisser un distributeur dicter aux artistes la façon dont ils doivent vendre leur musique. Nos artistes refusent que le format album soit démantelé par Apple ». Plus tard, d’autres ‘’rebelles’’ comme Green Day, Bon Jovi et Linkin Park suivront, puis rentreront gentiment dans le rang en acceptant finalement de voir leurs morceaux bradés à 1,29 € l’unité. La raison de ce revirement ? Encore une fois, la vision tristement courtermiste des 5 majors les plus puissantes. Portée par l’euphorie des premiers jours de vente sur iTunes et convaincue d’avoir trouvé là un remède au poison Napster, l’industrie du disque préfère – dans un premier temps – accepter les règles de Steve Jobs plutôt que de voir l’intégralité de ses revenus s’évaporer par la fenêtre. « 1 million de chansons téléchargées légalement en une semaine, c’est dingue ! Avec iTunes, Apple a su prouver aux fans, aux artistes et aux labels qu’il existait un moyen facile et légale pour distribuer la musique partout à travers la planète ». On sent bien la sueur d’excitation qui perle sur le front de Roger Ames, Président de Warner Music Group, en découvrant les impressionnants scores de ventes d’iTunes sur sa première semaine d’existence en 2003. On sent aussi toute la désespérance d’une industrie qui, faute d’avoir trouvé une meilleur parade, préfère encore se faire enfiler à sec. Et avec elle, tous les artistes qu’elle représente.
« Internet va sucer le contenu créatif jusqu’à la moelle, jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien » (David Byrne)
Dans son essai « Survival Strategies for Emerging Artists — and Megastars » publié chez Wired en 2007, David Byrne, leader des Talking Heads, anticipe ce sentiment de double trahison qui prévaut encore aujourd’hui : « 10 $ [env. 7€] pour
télécharger un « CD », de prime abord la nouvelle économie proposée par iTunes semble équitable. Et c’est certainement mieux pour les consommateurs. Mais une fois qu’Apple a pris ses 30%, le pourcentage de royalties s’applique et
l’artiste – surprise ! – ne s’en sort pas mieux. Ce n’est pas une
coïncidence si les conséquences sont similaires à celles de la
récente grève des auteurs d’Hollywood [qui arrivera finalement en 2008, NDR]. Est-ce que les artistes vont se rassembler et
faire la grève ? ». Evidemment que non. Personne ne débranchera les amplis, pas plus qu’il n’ouvrira sa gueule.
A la fin des années 2000, il est déjà trop tard pour se réveiller. Ayant compris qu’elles se font flouer dans les grandes largeurs par un Steve Jobs mourant, aucune des majors ne pourra inverser la tendance que toutes ont contribuer à lancer. En autorisant un prix de vente unique fixé à 99 cents, c’est autant la paupérisation des artistes que la dévalorisation définitive de l’œuvre musical qui est déjà en marche. Et ce qui devait être de l’aveu du patron d’Apple « une révolution » va, sous le poids de l’inexorable chute des ventes de Cds, engendrer une dernière mutation, encore plus problématique.
A la recherche du tempo perdu
A regarder de plus près l’histoire du MP3 à travers 3 décennies, on aurait presque l’impression d’une blague qui a mal tourné. Conçu par une poignée de chercheurs à peine plus nombreux qu’une équipe de basket, le format de compression a fini par devenir l’objet d’enjeux commerciaux qui tôt ou tard impliqueront l’ensemble des multinationales de l’industrie du plaisir. J’en veux pour preuve le mail reçu au moment même de l’écriture de ce papier par l’avocat pour la propriété intellectuelle du groupe Philips, alors même que je tentais de contacter un dénommé Leon van de Kerkhof, ingénieur néerlandais ayant travaillé au début des années 90 sur le squelette du MP3. La réponse de l’homme de loi : sans équivoque. Et pas de smiley à la fin : « I am an intellectual property lawyer
working for Koninklijke Philips, the previous employer of Leon
during the period in which he did his work regarding MP3
technologies. (…) We want to cooperate with you for your
request, and can agree to have the interview as long as we can
receive the questions beforehand, and are clearly given the
opportunity to review/edit the parts of the paper related to the
interview, before publication ». Pour les non anglophiles, une réponse à traduire d’un sobre : « coucou je
représente une marque internationale qui peut te briser les reins si
tu écris la moindre chose négative à notre propos concernant le MP3.
En cas de problème, deux Roumains t’attendent en bas de chez toi
dans une Mercedes. Bisou ».
Cet état de crispation, plus de 20 ans après la naissance d’un format devenu obsolète, traduit bien le sentiment d’insécurité qui a envahit tout le « milieu » depuis que chaque dollar est compté. Mais au delà du simple bilan comptable, les coups de boutoir portés contre la musique telle que nous l’avons connu ont fait bien plus que d’assécher le portefeuille des riches actionnaires d’Universal, Warner, EMI et consort. L’avènement du MP3, ce format ludique qui devait faire souffler un vent de liberté sur la contre-culture pop, a en réalité produit tous les effets contraires. De l’ouverture des vannes du tout gratuit avec Napster au contrôle de chaque écran pour interpeller les fraudeurs jusqu’à la régulation mafieuse pilotée par Apple, la compression du numérique a engendré une triple fracture. D’abord économique, puisque les bénéfices engendrés par la nouvelle économie numérique (iTunes, Youtube, Spotify, Deezer, etc) ne suffisent pas à compenser les pertes provoquées par l’apparition même de cette nouvelle économie. Un manque à gagner fatal pour les musiciens du nouveau siècle, contraint d’endosser le costume de super héros à double vie pour payer les factures en même temps qu’ils écrivent leurs partitions. Sociologique ensuite, puisque le MP3, en permettant la naissance de la culture de dissociation grâce à un accès instantané aux trouvailles les plus obscures allant du folk psychédélique turc jusqu’aux bootlegs les plus imbitables de Jim Morrison et ses garçons coiffeurs, peut être désigné comme le commanditaire direct de l’assassinat du mainstream. Après la mort de Cobain – et donc du grunge – plus aucun mouvement musical n’aura plus jamais la même portée sociétale. La raison ? Le désaveu des médias de masse par les plus jeunes, trop occupés à affirmer leurs différences sur des réseaux toujours plus spécialisés et confidentiels pour s’intéresser aux gouts du voisin – un voisin qui a pourtant lui aussi téléchargé illégalement l’album d’Arcade Fire en pensant être le premier à le faire. Et rupture générationnelle enfin. Puisque du jeunisme agressif en vigueur dans la pop music des années 60 jusqu’à la fin des années 90, avec chaque mois de nouveaux groupes écoulant – dans le pire des cas – 100.000 disques grâce à l’artillerie qu’est encore le média de masse (TV, presse), on assistera bientôt à ce formidable repli sur soi qu’est le marketing frileux.
Face au marasme que deviendra le marché du disque dès le milieu des années 2000, l’industrie du souvenir entrera alors en action. Nostalgie par paquet de douze, surexploitation des back catalogue (coffrets anniversaire de disques mythique, rééditions augmentées, etc) et révisionnisme agressif (en 2014 les lobbys du disque ont réussi à faire passer une directive européenne élargissant le droit de propriété du producteur de 50 à 75 ans pour les productions postérieures à 1962) deviendront bientôt la seule arme pour contrer la peur d’une énième tôle commercial sur des gamins inconnus du grand public. Voilà, c’est entendu : désormais les jeunes écouteront donc des disques de vieux, les vieux écouteront des disques de vieux. Quant à la nouveauté, hormis vous et moi bien entendu, elle ne fera plus bander personne, toute cloisonnée qu’elle est dans des niches inaudibles.
Disons le : en tuant la possession, les Docteurs Folamour ont simplement tué le sentiment d’appartenance. Elle est là, la triste vérité du MP3. Non contente d’avoir complètement reconditionné le gout des consommateur de musique, elle marque autant la fin de la possession intellectuelle (les ayants droits) que physique, puisque dématérialisée, la musique n’existe littéralement plus. Et n’a donc plus de valeur. Triste comme une ballade irlandaise… Et ça tombe bien, on y vient.

Songs of Innocence
Au jeu du questionnaire Proustien, si le MP3 était un animal ce serait certainement un rongeur. Grignotant non seulement les parts de marché, mais aussi le temps de cerveau disponible de ses utilisateurs. C’est peut-être le meilleur enseignement à tirer de la dernière polémique en date signée par des habitués du genre, U2, avec leur dernier disque en date « Songs of Innocence » délivré gratuitement à travers iTunes sur le disque dur de 500 millions d’utilisateurs. Une grande première certes, mais pas celle que l’on croit. Après 20 ans passées à militer pour une musique téléchargeable gratuitement, voici que les internautes du monde entier s’élèvent comme un seul homme pour protester contre l’odieux procédé consistant à… leur proposer un disque téléchargeable gratuitement. Point Godwin, balle au centre.
S’il est évident que les motifs de mécontentement étaient tout autre, et que non Bono, c’était pas très malin de fourguer aux utilisateurs un disque relativement médiocre sans leur demander la permission, cette situation paradoxale – une de plus – symbolise la boucle en train de se boucler dans l’étrange monde de la musique digitale. Fait inédit, et pour la première fois en 13 ans, l’iTunes d’Apple aurait selon le Wall Street Journal connu en 2014 sa première reculade. 14% de ventes en moins sur la première plateforme de vente de fichiers musicaux, alors même que le streaming a gagné 46% de parts de marché au point de s’imposer aujourd’hui comme l’incontournable acteur de la musique de demain. Avec à la clef pour le musicien encore moins de revenus et toujours plus de difficultés pour toucher un public qui renâcle de plus en plus à lâcher le moindre centime pour la moindre note. « Un basculement dans la manière qu’ont les consommateurs d’écouter la musique », dixit le WSJ. Tu m’étonnes, John. A moins d’imaginer une reconversion inédite des acteurs de l’industrie dans la revente au gros de MP3 d’occasion, voire un nouveau format « révolutionnaire » où le musicien serait contraint de payer ses fans pour être entendu, difficile d’imaginer pire dénouement pour le format né voilà 20 ans. Big money, but for nothing. La vérité, c’est que nous avons tous appuyé sur la gâchette et qu’il n’y a plus personne sur qui tirer.
A l’heure où s’écrivent les dernières lignes de l’histoire de ce MP3 usé jusqu’à la corde, relisons donc une dernière fois Walter Benjamin
« A la plus parfaite reproduction il manquera toujours une chose : le hic et le nunc de l’œuvre d’art – l’unicité de son existence au lieu où elle se trouve. C’est cette existence unique pourtant, et elle seule, qui, aussi longtemps qu’elle dure, subit le travail de l’histoire ».
Plus qu’une révolution, le MP3 était donc un mirage annonçant surtout un perte de l’aura artistique et donc, du pouvoir d’influence de l’artiste sur les masses. Pas de « Thriller » sans ses 65 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde. Un temps reine incontestée de la pop, même Madonna en est aujourd’hui réduit à offrir gratuitement 6 chansons de son prochain album, pressée par les fuites et la peur de disparaître avant d’avoir été entendu. Dans toute séduction, il y a un rapport de force. Celui qui unissait les popstars à leurs publics semble s’être tordue pour un bon bout de temps. Jusqu’à ce que tout recommence, pour citer Duras,
« par une indiscipline, un risque pris par l’homme envers lui-même. Le jour où il sera seul de nouveau, avec son malheur, et son bonheur, mais qui lui viendront de lui-même. Peut-être que ceux qui se tireront de ce pas seront les héros de l’avenir, c’est très possible, espérons qu’il y en aura encore… ».